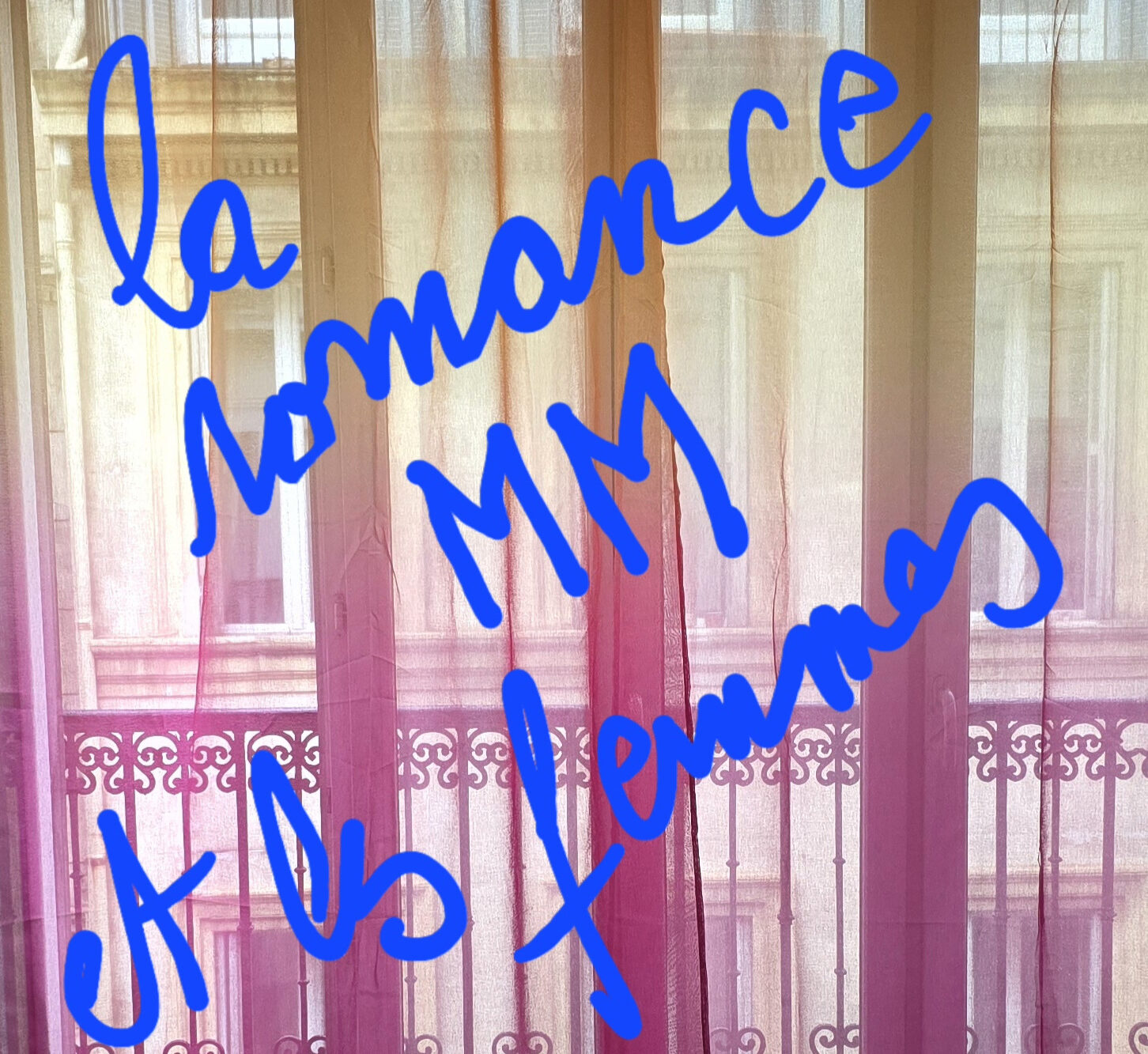
La romance MM et les femmes

RML
Qu’est-ce que c’est que ce machin, la romance MM ? Je suis sûr que beaucoup d’entre vous n’en ont jamais entendu parler. Et peut-être aussi, quelques-unes et quelques-uns en ont déjà lu…
Alors c’est quoi ?
La romance MM, ou Male to Male, est un sous-genre de la littérature romantique qui met en scène des relations amoureuses entre hommes. En résumé, c’est la collection Harlequin, mais entre hommes… et c’est plutôt une collection Harlequin épicée, car on y trouve souvent des scènes de sexe assez explicites, voire rugueuses (hum).
Bon. J’avoue avoir découvert ces romances il y a environ sept ans, et en avoir lu quelques-unes. Ne vous moquez pas. Je lis beaucoup de choses, et très différentes ! J’en parlerai peut-être un jour dans le podcast…
Depuis ma découverte, ce genre a encore gagné en popularité, notamment auprès des lectrices féminines. C’est cela qui m’a intrigué en premier : la majorité des lecteurs sont des lectrices hétérosexuelles. Et double coup de théâtre : la majorité des auteurs sont des autrices hétérosexuelles !
Nous avons donc affaire à un genre, la romance à caractère érotique explicite, qui met en scène des hommes gays, et qui est majoritairement écrit et lu par des femmes !
Il y a matière à susciter des débats sur les motivations des autrices et les perceptions des lecteurs. Ce qui n’a pas manqué d’arriver.
Je vous fais un point de ce que j’ai trouvé à ce sujet.
Les motivations des autrices
1. Évasion et fantasme :
Certaines lectrices apprécient la romance MM, car elle leur permet de sortir des clichés traditionnels de la romance hétérosexuelle classique, où l’héroïne est souvent effacée, voire un simple objet de désir de l’homme. La romance MM offre une perspective différente, souvent décrite comme plus intense et émotionnelle, sans identification directe possible avec un personnage féminin.
Écrire de la romance MM permet aux autrices d’explorer des relations différentes de celles traditionnellement représentées dans la romance hétérosexuelle. Cela peut offrir une forme d’évasion créative (en tout cas c’est ce que la majorité d’entre elles expriment en interview), et elles peuvent développer des personnages et des intrigues sans les contraintes des stéréotypes de genre habituels. En investissant des personnages masculins (souvent les mêmes archétypes que dans les romances traditionnelles, c’est-à-dire le cowboy, le sportif, le flic, le pompier, l’homme d’affaires, le prince, etc.), elles affirment souvent leur côté entreprenant et actif, tout en leur donnant une grande sensibilité (ce qui est nouveau). C’est cette double assignation sur la figure masculine qui, sans doute, donne au lectorat cette impression d’intensité et d’émotion.
En écrivant des histoires d’amour entre hommes, les autrices affirment offrir aussi une diversité de perspectives et de représentations, contribuant ainsi à une littérature plus inclusive.
Pour ma part, je me suis toujours demandé si les scènes de sexe entre hommes pouvaient être le pendant des scènes de sexe entre femmes dans les pornos masculins hétéros. J’avoue ne pas avoir trouvé la réponse sur le net à ma question.
2. Visibilité et représentation :
Les autrices expliquent aussi contribuer à la visibilité de la communauté LGBTQIA+ en écrivant des histoires qui mettent en avant des personnages homosexuels. Cela peut, en effet, aider à normaliser ces relations et à sensibiliser le public aux défis auxquels cette communauté est confrontée, comme le coming-out et l’homophobie. (même si, dans mon expérience, j’ai plus souvent vu le coming-out représenté que l’homophobie. Dans ces récits, la possibilité d’un désir et d’un aboutissement de celui-ci est souvent accueillie sans trop de réserves par une société très résiliente.)
Ces récits peuvent également servir d’outils éducatifs pour sensibiliser aux réalités vécues par les personnes LGBTQIA+, favorisant ainsi une meilleure compréhension et acceptation. Et pour aller plus loin, je dirais même que l’enjeu de la représentation est central.
3. Liberté créative et demande de marché :
Écrire de la romance MM est souvent perçu comme une forme de liberté créative, où les autrices peuvent développer des personnages et des intrigues sans les contraintes des stéréotypes de genre. Certaines autrices passionnées par l’écriture de romances trouvent dans le sous-genre MM un moyen d’exprimer leur créativité et leurs émotions de manière authentique. Écrire ces histoires d’amour intenses et émotionnellement chargées leur permet de se connecter avec leur lectorat sur un plan émotionnel profond, en explorant des thèmes universels, comme l’amour, le sacrifice et la résilience, sans les codes que la société impose souvent aux femmes. En mettant en scène des hommes, elles sont totalement libérées des pressions sociétales hétéronormées, et certaines prétendent même qu’elles parviennent ainsi à une vraie parole intime, paradoxalement féminine.
J’ai lu des entretiens avec certaines autrices qui affirment devenir de meilleures autrices en développant une empathie avec des personnages masculins souvent leur opposé.
Néanmoins, au fil du temps, apparaît aussi une normalisation de ces romances. Ces nouveaux codes ont aussi créé une attente auprès du lectorat. Le succès croissant de la romance MM est aussi devenu, ne nous voilons pas la face, une motivation économique pour les autrices qui voient là une opportunité de toucher un large public.
La demande du marché, naturellement, vient contredire le sentiment de liberté qu’a généré la romance MM.
Perceptions et débats
Les débats autour des motivations des autrices écrivant de la romance MM touchent à des questions sensibles de représentation, d’appropriation culturelle et de liberté créative. Récemment, la communauté LGBTQIA+ s’y est intéressée et a montré ses réserves.
1. Appropriation et fétichisation :
Certains membres de la communauté LGBTQIA+ expriment des préoccupations quant à l’appropriation culturelle, c’est-à-dire l’utilisation de leurs expériences et de leur identité par des personnes extérieures à la communauté. Les autrices hétérosexuelles écrivant de la romance MM peuvent être perçues comme s’appropriant des histoires qui ne sont pas les leurs, surtout si elles ne font pas preuve de sensibilité ou de compréhension approfondie des enjeux LGBTQIA+.
Il existe une crainte que ces histoires soient écrites pour satisfaire des fantasmes plutôt que pour représenter fidèlement les expériences des hommes homosexuels. Cela peut conduire à une fétichisation des relations homosexuelles, où elles sont perçues comme exotiques ou érotiques plutôt que comme des relations humaines authentiques.
2. Authenticité et représentation :
La question de l’authenticité se pose également. On peut se demander si les autrices hétérosexuelles peuvent représenter fidèlement les expériences et les émotions des hommes homosexuels. Évidemment, la fiction permet une grande liberté et l’authenticité peut être atteinte par des recherches approfondies et une sensibilité aux sujets abordés.
La question de savoir si une autrice hétérosexuelle peut représenter de manière authentique les expériences et les émotions des hommes homosexuels est au cœur du débat.
La représentation des personnages LGBTQIA+ dans la littérature est cruciale pour la visibilité et l’acceptation d’une communauté qui a été et est encore (faut-il le rappeler ?) agressée dans la majorité des pays, en dépit d’une avancée de ses droits. Une mauvaise représentation pourrait renforcer les stéréotypes et nuire davantage. Il est donc important que les autrices abordent ces sujets avec soin et respect.
3. Diversité des voix, et impact sur la communauté LGBTQIA+ :
Les défenseurs de la liberté de création soutiennent que les autrices doivent avoir la liberté d’écrire sur n’importe quel sujet, indépendamment de leur propre identité. La fiction permet d’explorer différentes perspectives et expériences, et limiter les autrices à écrire uniquement sur ce qu’elles connaissent personnellement serait un vrai appauvrissement littéraire.
Toutefois, il existe un vrai risque que les voix des auteurs LGBTQIA+ soient noyées par celles des autrices hétérosexuelles, surtout si ces dernières dominent le marché de la romance MM, ce qui est mathématiquement une réalité.
Il est donc important de soutenir et de promouvoir également les œuvres des auteurs LGBTQIA+ pour garantir une représentation équilibrée.
En conclusion
Comme on a pu le lire, le sujet est délicat. Et à mon avis, le débat ne fait que commencer.
Et moi, dans tout ça ? Qu’est-ce que j’en pense ?
Eh bien, je suis partagé. D’un côté, je crois profondément à la liberté d’écrire sur tout. D’autre part, je suis sensible aux réserves, fondées, d’une communauté minoritaire.
Il me semble donc que la seule réponse possible est du côté de la lectrice, du lecteur. Finalement, le fait que la romance MM soit écrite par une femme ou un homme n’a aucune importance. Par contre, rejetons les romances qui ressemblent à des produits stéréotypés et qui véhiculent des schémas blessants ou éculés. Osons.
Et je vous encourage à découvrir la romance MM. Il y a de vrais bijoux.
J’espère que ce sujet vous a intéressé… je vous dis à la prochaine fois, et n’hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, ici. Je n’abuserai pas de votre boîte aux lettres, c’est promis.